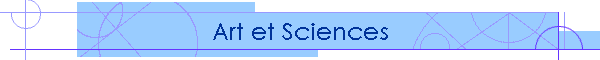
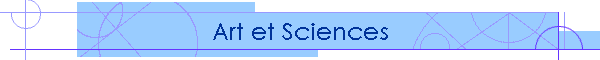
|
Photographie et sciencesPar Nicolas Mayot
Photographie et science La photographie est considérée comme un art à part entière. Pourtant cet art qui permet de figer des images a de nombreuses applications dans le monde de la science et plus particulièrement dans les sciences du vivant. Un peu d’histoire… Quelles qu'aient été les possibilités descriptives ou expérimentales originaires de l'outil photographique, il faut constater que celles-ci furent d'abord peu exploitées, et surtout contrebalancées, pendant plusieurs décennies, par une appréciation globalement négative des résultats produits. Nombreux sont les débats du XIXe siècle (par exemple celui sur la ressemblance du portrait photographique, desservi par ce qu'on décrivait alors comme une trop grande fidélité) qui apparaissent aujourd'hui comme des querelles saugrenues. L'aspect révolutionnaire du geste galiléen, on le sait, ne fut pas de tourner la lunette astronomique vers le ciel, mais de faire confiance à l'information visuelle fournie par l'instrument, jusque-là tenue pour incertaine. De même, la détermination de la photographie comme outil de vision repose fondamentalement sur une modification de la perception des images produites modification qui dépendait moins des résultats effectifs que de leur interprétation, dans le cadre d'une stratégie volontariste de rapprochement de la photographie et des sciences.
Avant 1876, les rares exemples de son usage en astronomie, en anthropologie, en médecine ou en sciences naturelles se limitent à des tentatives ponctuelles, isolées, et n'ont fourni que des résultats peu concluants, sinon franchement inutilisables. Néanmoins, l'astronome Hervé Faye, à propos des observations de passages de planètes sur le Soleil, suggérait de " supprimer l'oeil infidèle de l'observateur " et de recourir aux procédés photographiques pour remédier aux incertitudes de la vision. C’est justement à l’occasion du passage d’une éclipse de venus sur le soleil (phénomènes ne se passant que 2fois tous les 123 ans) que la photographie et la science furent pour la première fois intimement lié grâce, notamment à Jules Janssen Scientifique célébré en son temps à l'égal de Pasteur, l'astronome Jules Janssen (1824-1907), membre de l'Institut, directeur de l'observatoire de Meudon, fut aussi l'un des principaux acteurs du vaste mouvement d'émancipation de la photographie à la fin du XIXe siècle. Pourtant, avant 1873, Janssen n'avait jamais eu recours à la photographie. De son propre aveu, « c'est l'observation du passage de Vénus qui a attiré plus spécialement [son] attention sur cette branche si féconde et si délaissée chez nous ». À l'origine de sa notoriété et de son rôle institutionnel dans le champ photographique, une expérience singulière: celle effectuée en 1874, à l'occasion d'une éclipse du Soleil par la planète Vénus, avec un dispositif de son invention, le "Revolver photographique". Constamment mentionné dans les ouvrages spécialisés comme le premier exemple de chronophotographie, élu par les frères Lumière comme l'ancêtre du Cinématographe, le célèbre appareil n'a pourtant produit que de bien maigres résultats sur le plan de l'observation astronomique. Pour Janssen comme pour de nombreux autres astronomes, le programme du passage de Vénus aura néanmoins apporté le bénéfice d'une familiarisation avec les techniques photographiques. La pratique photographique s’émancipe alors. Selon Janssen : " La photographie est la rétine du savant ". La « méthode graphique » de Marey Par la suite le physiologiste français Étienne-Jules Marey " et ses contemporains se sont tournés vers la production mécanique d'images afin d'éliminer toute médiation suspecte ", abolissant ainsi " l'intervention humaine entre la nature et sa représentation ". On lit ainsi dans La Méthode graphique rédigée en 1878 : " Non seulement ces appareils sont destinés à remplacer parfois l'observateur, et dans ces circonstances s'acquittent de leur rôle avec une supériorité incontestable ; mais ils ont aussi leur domaine propre où rien ne peut les remplacer. Quand l'oeil cesse de voir, l'oreille d'entendre, et le tact de sentir, ou bien quand nos sens nous donnent de trompeuses apparences, ces appareils sont comme des sens nouveaux d'une étonnante précision. " Ce nouveau courant de pensée recherche plus d’objectivité : " Personne ne doute aujourd'hui qu'il ne faille se défier des témoignages de la vue, de l'ouïe ou du toucher. La sphéricité de la terre, sa rotation diurne, les distances des astres et leurs volumes immenses, toutes nos connaissances astronomiques pour ainsi dire, sont autant de démentis donnés à l'appréciation de nos sens. ". « L’objectivité visait au contraire l'idéal d'une machine : d'une machine conçue comme un opérateur neutre et transparent qui devait servir d'instrument enregistreur en l'absence de toute intervention ; d'une machine incarnant un idéal auquel les savants eux-mêmes devaient tendre dans leur discipline morale. L'objectivité, c'est ce qui restait quand étaient exclues la part de la subjectivité, de l'interprétation, de l'art. " Enfin dans Le Mouvement, Marey propose de l'activité photographique cette définition succincte : " La photographie [par opposition à l'oeuvre d'un artiste] donne instantanément l'image des objets les plus multiples, avec leur perspective correcte, et dans les conditions d'éclairage où ils se trouvaient tous à un même instant. Elle traduit ainsi l'aspect des corps de la nature, tels que nous les voyons en les regardant d'un seul oeil. " De nos jours… Aujourd’hui, photographie et science font toujours bon ménage. La photographie est toujours utilisé en astronomie pour l’observation des astres, couplés à de télescopes de plus en plus performant. L’avènement de la photographie numérique a aussi fortement facilité son utilisation. Le temps et les coûts de développement ne sont plus des freins et l’analyse des photographies sur ordinateur en est facilitée. On peut citer quelques exemples comme dans le monde de l’écologie. Ainsi, les photographies aériennes sont utilisées pour l’étude des surfaces couvertes par certains écosystèmes après analyses des surfaces grâce un ordinateur et intégration dans un système d’information géographique. En science du vivant, la chronophotographie est souvent utilisé dabs la cadre d’étude du mouvement, même si petit à petit elle est remplacée par la vidéo. En ethnologie et sociologie aussi, la photographie permet de fixer les comportements pour ensuite les étudier. Utilisation de la photographie sous marine S'il est un univers scientifique ou la photographie est indispensable il s’agit de la biologie marine. En effet, dans un espace où le temps de résidence, donc d’observation, est limité, l’utilisation d’un outil permettant de fixer les observations pour ensuite les analyser au sec est primordiale. Dans ces conditions, l’expression « rétine du savant » (voir plus haut) prend tout son sens. Ainsi, pour mesurer les surfaces colonisées une espèce, il est plus simple de prendre plusieurs photographies et de les analyser à la surface, plutôt que de faire l’ensemble des mesures sous l’eau. De la même manière, la photographie est utile dans le cadre de recensement d’espèces présentes dans un écosystème ou un site particulier et permet d’observer et de dénombrer (après analyses des photos en surface) plus d’espèces en un minimum de temps. La photographie (au même titre que la vidéo) permet aussi d’observer et de figer les comportements animaliers afin ensuite de les interpréter et les comprendre une fois à la surface. L’utilisation de la photographie a remplacé et même largement dépasser les schémas et dessin des anciens biologistes pour l’illustrations des espèces et leur caractérisation. Légende des photos :
Mérou de méditerranée (copyright S. Ruitton)
tombant à corraligènes (copyright S. Ruitton) |