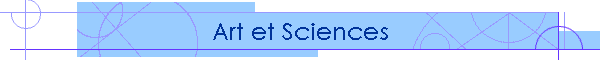
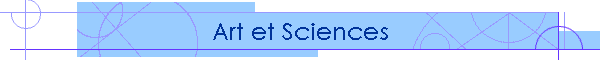
|
Le chant grégorien, un sujet scientifique !Par Bertrand Renard
La musique est intrinsèquement scientifique et a longtemps été enseignée comme telle : fréquences des notes, échelles toniques ou modales et régularité rythmique sont des domaines qui invitent à une rigueur de calcul. La science du rythme trouve dans le chant grégorien une mine particulièrement intéressante parce que c’est un chant historiquement premier, très dépouillé et ainsi plus facilement décomposable pour être analysé, parce que son écriture souple et essentiellement mélodique trahit un rythme souple, parce que sa relative irrégularité rythmique pose la question de la précision du rythme, et enfin parce qu’en tant que chant propre de la liturgie romaine, il a traversé deux millénaires pour parvenir jusqu’à nous relativement préservé.
Invention de l’écriture musicaleLa musique médiévale nous a léguée le chant grégorien, musique modale utilisant des gammes naturelles sans altération, musique monodique où tous chantent simplement la même mélodie, et musique liturgique que l’on peut qualifier de calme, solennelle et contemplative. Le chant grégorien se place à la genèse de l’écriture de la musique et du rythme : l’invention de l’écriture musicale parallèlement en différents endroits d’Europe est visible dans les premières partitions, dès le début du IXème siècle, qui utilisaient des symboles différents pour cristalliser les mêmes mélodies véhiculées par tradition orale. Ces symboles ou neumes se transforment sur les manuscrits à la plume d’oie en notes carrées avec l’invention des portées. Dans la continuité de musiques modales latines et grecques, le chant médiéval est à la source de l’évolution de la musique occidentale vers l’isson, le déchant, le contrepoint puis la polyphonie baroque.
extrait de l’introït de Noël « Puer natus est », avec le manuscrit de Laon (haut), la notation classique par neumes sur quatre portées et le manuscrit de St Gall (bas)
Rythme naturelToute musique –excepté une harmonie de sons filés et évanescents– se base sur des temps plus ou moins importants. Comme la marche ou la danse, la musique s’appuie sur les points d’ancrage qui structurent le temps et sont reliés par des temps moins importants. Comme la musique s'inspire de la danse qui l’illustre, l’analogie du rythme avec les appuis et levés d’un déplacement du corps (d’une jambe) est judicieuse car elle montre que le rythme peut être lié indifféremment à l’intensité, à la mélodie ou à la durée. Le rythme naît de l’hétérogénéité de ces paramètre physiques qui ne sont que des supports du relief rythmique, dans chacune des dimension (mélodie, intensité, durée). Le rythme n’est donc pas constitué de hauteur de note, intensité, couleurs de voyelles tempo, durées de notes et accents, mais réside dans les variations d’un ou plusieurs de ces paramètres énergétiques, se balançant entre les points d’ancrages ou temps importants.
Rythme structuré mais non métréTandis que nos oreilles sont habituées aux danses et compositions classiques métrées (c’est à dire avec des temps réguliers groupés dans des mesures régulières), le chant grégorien n’obéit pas à des règles strictes de régularité. Vecteur du texte, il se veut mise en relief des phrases latines ou grecques. La prononciation des syllabes constitue ainsi la durée de base du rythme. Le chant grégorien ne se base pas sur un tempo et des rythmes de précision comptable, mais utilise des indications de variations par rapport à un tempo de base. Ce tempo de base, lié à la prononciation aisée des syllabes, dépendra du lieu (réverbération) et du nombre des interprètes. Les variations de durée –note doublée, triplée, pointée, épisèmée, accentuée…– ne sont pas toutes définies de manière stricte, ce qui n’empêche pas une certaine rigueur dans l’interprétation historique du rythme grégorien.
Synthèse intellectuelle anticipatrice d’ordre énergétiqueL’interprète qui traduit une partition en musique pour l’oreille effectue une synthèse pour rendre intelligible le texte et la musique. Le déchiffrage est –par opposition– inintelligible car le chanteur découvre la partition au fur et à mesure et se contente de chanter mécaniquement ce qui est écrit. Le rythme est donc une synthèse intellectuelle anticipatrice. Elle s’exprime dans les variations d’énergie locales et globales (phrasé). Le rythme est ainsi parfaitement rationnel mais non comptable, et le chant grégorien invite naturellement à l’expressivité musicale.
Conclusion : Art et scienceLe rythme grégorien n’est pas régulier, mais la vie et l’art lui sont donnés par les variations d’énergie qui s’expriment dans les variations de tempo, de durée, d’intensité ou de mélodie. Ces irrégularités volontaires du rythme sont présentes également dans la musique classique ou contemporaine dans les notions de crescendo-decrescendo, son filé, syncope, etc. De manière moins visible qu’en chant grégorien, car le rythme doit y respecter d’assez près la régularité de la mesure, les irrégularités sont présentes dans toutes les formes de musique et y jouent un rôle crucial. C’est grâce à elles que s’introduisent l’art et l’expressivité qui vont différentier deux interprétations et empêcheront toujours une machine de produire de la belle musique. De même que la danse est un art qui coordonne et unifie les danseurs par le rythme, le maître de chœur va unifier tous les choristes en imposant son interprétation artistique du rythme.
SourcesDom André Mocquereau, Le nombre musical grégorien, Desclées 1908 Jean de Valois, Le chant grégorien, (Que sais-je n°1041), PUF 1963 Graduale Triplex, Solesmes, 1979 Dom Joseph Pothier, Les mélodies grégoriennes, Stock musique 1980 Pierre Billaud, Rythme et sémiologie du chant grégorien, 2001 Dom Courau, Entretien avec un moine sur le chant grégorien, 2001 Philippe Bévillard, thèse sur la rythmique grégorienne, retour aux fondations physiques de la dynamique des flux acoustiques |