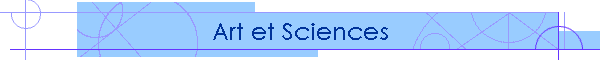
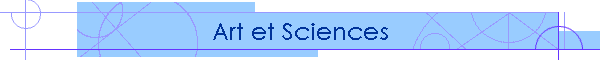
|
Le droit cet inconnu...au confluent de l'art et de la sciencePar Guillaume Boudou
Malgré toute la prudence qu’une telle démarche ne manque pas d’imposer et au-delà des divergences doctrinales, les juristes français[1] définissent traditionnellement le droit, soit sous un angle objectif comme un ensemble de règles sanctionnées par l’Etat et participant prioritairement au maintien de l’ordre social, soit sous un angle subjectif comme l’ensemble des prérogatives individuelles qui permettent à son titulaire de faire, d’exiger ou d’interdire quelque chose[2]. Toutefois, pour utiles que soient ces deux acceptions du mot « droit », elles n’en sont pas moins le résultat d’efforts de définition poussés, qui, du même coup, par hermétisme, risque de n’intéresser que les seuls juristes et par-là retrancher encore un peu plus le droit et ses ministres dans une insularité déjà avérée. Aussi, dans la perspective d’un travail pluridisciplinaire, délaisserons-nous ce vocabulaire jargonneux, pour ne retenir que l’aspect « sociologique » du droit, visible par tous. En d’autres termes, plutôt que le droit lui-même, c’est bien l’activité qu’il suscite, et qu’un fâcheux raccourci de langage désigne du même terme, que nous allons tenter d’analyser. « Faire du droit », « faire acte de juriste », est-ce faire de l’art ou de la science ? Dans la « rencontre » de l’art et de la science, à ce dîner, a priori improbable, mais que l’on espère amoureux à l’envi, les sectateurs du droit sentent la pièce rapportée, celle qui semblerait devoir tenir la chandelle. En effet, dans l’esprit commun, le juriste est cet animal curieux, chimérique oserait-on dire, que l’on ne connaît qu’entre aperçu de loin, au mieux ce ténor du barreau arrachant l’innocent aux griffes d’une peine laissant désormais le condamné accompagné de sa tête, au pire ce beau parleur dissimulant habillement les faiblesses d’une cause sous des effets de manches mitées, volontiers séducteur à l’épitoge jaunie. Mais, par-delà les vicissitudes, les égarements intellectuels et autres croyances populaires de chacun, une certitude s’impose, cinglante : le juriste n’est ni un artiste, ni un scientifique. Et pourtant, le droit et le travail de ceux qui en font leur profession est tout à la fois un art (I) et une science (II). Pour cette raison, le modeste vœu, que nous formulons à l’occasion de cette entreprise commune, est que du candélabre indésirable jaillisse une lumière qui éclaire artistes et scientifiques sur la proximité possible de leur démarche respective, pour que, à l’instar du droit, elles se rencontrent, s’apprivoisent et s’épousent en se mêlant aux mêmes eaux.
I. L’art du droit
Si l’on entend par « art », la « technique, [la] méthode, [l’] ensemble des procédés ou des règles propres à chaque genre de l’activité humaine et qui vient s’ajouter aux dons naturels », mais aussi l’« activité désintéressée qui a son but et sa fin en elle-même, selon un idéal esthétique »[3], alors se font très nettement jour deux façons d’appréhender le droit comme un art, tantôt dans son sens premier et étymologique[4], comme une pratique, la mise en application d’un certain savoir-faire (A), tantôt dans un sens dérivé comme un phénomène s’exprimant dans la quête du beau (B).
A. La pratique du droit
Le droit semble s’affirmer de longue date comme une pratique. Ainsi, la seule définition du droit que la Rome ancienne[5] -dont on se plaît souvent à rappeler qu’elle fut la « mère du droit »- nous ait léguée est celle, largement admise[6], du jurisconsulte Celse : « Ius est ars boni et æqui » (« Le droit est l’art du bon et du juste »). En effet, le pragmatisme extrêmement poussé des Romains les a conduit à concevoir l’existence d’un droit non pas à partir de son édiction abstraite dans un texte de loi, mais dès lors que celui-ci a été consacré dans son application par un juge. A Rome, l’action précède le droit. Si bien que la restitution d’une chronologie juridique romaine suit l’évolution de la procédure en distinguant période archaïque et actions de la loi, période classique et procédure formulaire, période post-classique et procédure extraordinaire[7]. Mais surtout, le grand mérite, et par-là même la puissance, de la définition de Celse est de concevoir la validité du droit en tant que système au service du bon et de l’équitable et non parce qu’il procède de la force effective de l’Etat[8]. En liant le droit à la justice, notion éminemment plastique[9], les Romains ont fourni les moyens de sa nécessaire adaptation au cours des âges. Aujourd’hui encore le droit romain marque notre conception de sa large empreinte. Ainsi, conçoit-on mal que le droit puisse se détourner de sa finalité pratique, notamment contentieuse, en ne mettant pas fin à un conflit d’intérêts, ou en ne rendant pas à chacun ce qui lui est dû. Le lien entre le droit et le juste est à ce point ténu, qu’il a pu donné naissance à de chaudes controverses, comme, par exemple, autour l’existence d’un droit nazi[10]. On citera encore l’exemple tristement célèbre d’une mère acculée à voler un pain pour nourrir ses enfants. Dans cette espèce, la lettre d’un texte jugée trop rigoureux et inique avait conduit les juges à voir dans le fait d’être contraint, pour sa survie, à soustraire de la possession d’autrui un produit de première subsistance, un acte dépourvu d’intention frauduleuse[11].
B. L’esthétique du droit
Le droit est en relation permanente avec la recherche du beau, soit qu’il soit lui-même à finalité esthétique, soit qu’il soit mis en relation avec un art au service d’un idéal esthétique différent. Ainsi, en va-t-il de la formulation, quasi-poétique de certains adages, brocards et autres sentences du droit[12]. Mais le droit peut aussi mettre à contribution des arts divers aux logiques esthétiques différentes pour venir au soutien de son autorité, de sa manifestation ou de sa preuve, ainsi la littérature[13]ou la rhétorique[14]. A l’inverse, le droit et l’idéal de justice qu’il sert, peuvent être pris comme sujet par un certain nombre d’arts, pictural au premier chef[15], mais encore l’architecture ou les arts décoratifs. La synthèse de ces interactions se manifeste de manière tout à fait patente à l’occasion du procès criminel, dans ce qu’il est désormais entendu d’appeler « rituel judiciaire de l’ordre imposé »[16]. L’audience s’ouvre sur la lecture de l’arrêt rendu par la Chambre de l’instruction, opérant un rappel des faits[17]. Toutefois ce chaos ne doit pas s’étendre. Une fois celui-ci évoqué, des personnages le prennent en charge, tous recouverts d’une robe[18], qui n’est évidemment pas seulement un vêtement[19], c’est un riche signifiant[20]. En outre, comme pour toute cérémonie, le rituel judiciaire impose un lieu spécifique pour que la justice y soit rendue. En effet, le prétoire est une pièce elle aussi chargée de symboles. En premier lieu, comme le souligne Jean Carbonnier [21], il est pour le moins fréquent que les actuelles salles d’audience soient garnies de bois (parquet, lambris en tout genre etc…). Or, une filiation directe est à établir avec le fait qu’aux origines de l’activité judiciaire, il est des us et coutumes que le seigneur rende la justice à l’ombre d’un arbre, généralement un chêne. Ce dernier est porteur d’une double symbolique[22]. D’une part le chêne est investi des privilèges de la divinité[23], et d’autre part, il incarne la force[24] et corrélativement la stabilité. Si la justice a, semble-t-il, de longue date eu recours à cette symbolique, c’est parce qu’elle rejaillit sur l’image qui doit être la sienne : assurer le maintien de l’ordre social par l’application des règles de droit qui en sont en partie les garantes. En deuxième lieu, il s’agit de l’indispensable buste de Marianne, placé juste au-dessus des juges, allégorie de la République, au nom de laquelle justice est faite[25]. En troisième lieu, il s’agit de l’agencement de la salle d’audience. On remarque que celui-ci est toujours le même. En effet, dans un prétoire les juges sont acculés au fond, ceux-ci bénéficiant pour seule issue d’entrée et de sortie d’une porte qui leur est réservée, et, à l’autre bout, le public. Autrement dit, tout s’organise autour d’un espace infranchissable entre les juges et le profane[26]. Claude Le Faure nous dit que la démocratie n’est le pouvoir de personne, c’est le lieu vide de la Loi. Il existerait donc une entité fictive, « occupable » par personne : celui de la Loi. Il s’avère alors que cette symbolique est très vivante dans le prétoire où tout s’organise autour de cette distanciation interne.
II. La science du droit
La science est « tout corps de connaissances ayant un objet déterminé et reconnu, et une méthode propre ; domaine du savoir en ce sens »[27]. Pour affirmer que le droit est une science, il convient donc d’en montrer quelle est son objet (A’) et sa méthode (B’).
A’. L’objet du droit
En tant que tel, le droit est une science normative, qui, partant, a un double objet : des normes identifiées et les valeurs qu’elles portent. Cela signifie que le champ d’investigation du juriste peut aussi bien être le droit positif, directement utilitaire, que le phénomène juridique dans son entièreté, tant pour son amélioration que comme objet de spéculation. Si la règle de droit peut être considérée comme le premier objet d’étude du juriste c’est parce qu’elle se distingue nettement d’autres ensembles normatifs tels que la morale ou la religion. Toutefois, cette séparation[28] est regrettable à plus d’un titre ; entre autres choses, parce qu’elle conduit à isoler la règle de droit par le critère de la coercition étatique, sanction dont sont dépourvues les règles morales et religieuses, et, par voie de conséquence, à poser l’existence du binôme Droit-Etat, avec pour effet aberrant de priver d’un droit les sociétés traditionnelles, généralement aétatiques. C’est là une différence sensible avec le droit romain aussi bien préchrétien que chrétien, qui ignore la séparation entre droit, morale et religion. Si les Romains distinguent ius, mos et religio, il demeure que ces trois ensembles normatifs sont intimement liés. Le ius s’intègre aux règles de la morale (honestum), mais s’écarte des règles morales obligatoires seulement devant la conscience et qui peuvent être enfreintes sans répression. En outre, le droit naturel (ius naturale)[29] s’adresse aux hommes mais leur échappe pour sa formulation : il relève donc pour sa révélation de la philosophie ou du discours religieux. Ainsi, dans la mesure où l’ordre naturel est aussi, pour tout ou partie, l’œuvre d’une volonté divine, le droit naturel peut apparaître comme ensemble de normes médiantes entre le les desseins des dieux (fas) et le ius auquel il appartient.
B’. La méthode du droit[30]
C’est à la fin du xixe siècle, que la science du droit tend véritablement à se constituer comme science moderne, sous l’impulsion d’une nouvelle école, dite « scientifique ». C’est une école de pensée qui se développe, dès les années 1880, en réaction aux excès de l’Ecole de l’Exégèse[31]. L’Ecole scientifique refuse de considérer la loi comme source unique de droit. Elle en admet la prééminence, mais la coutume, la jurisprudence, la doctrine, l’équité doivent également être reconnues comme source de droit et le juriste doit y rechercher les solutions les plus justes en complément à la loi. C’est donc par la libre recherche scientifique que le juriste doit s’efforcer de dégager le droit de son temps[32]. Cet élargissement des sources du droit induit aussi un élargissement dans la première prémisse du raisonnement juridique. Celui-ci est généralement présenté comme un syllogisme qualifié de judiciaire, parce qu’il est prioritairement celui du juge et consiste en l’application – ou mieux l’appropriation- d’une règle générale et abstraite (la majeure) à un cas d’espèce particulier et toujours unique (la mineure), pour en déduire une solution, celle qui prend la forme d’un dispositif dans les décisions de justice. A quoi il convient de rajouter, qu’en pratique, on assiste, plutôt qu’à un seul syllogisme, à un enchainement de syllogismes dans lesquels la conclusion du syllogisme précédent devient la mineure du syllogisme suivant, ce qui fait du raisonnement juridique une sorte de sorite à répercussion. Enfin, l’on fera remarquer que le rapport du droit au fait, qui semble de la sorte caractériser la méthode du droit, passe par le préalable nécessaire de la qualification, c’est-à-dire l’intégration d’une donnée de fait à une catégorie juridique préexistante. En effet, seule la qualification permet le rapport du droit au fait, dès lors que la mineure, donnée factuelle, ne peut être mise en relation avec la majeure, donnée purement juridique, qu’une fois exprimée dans un même champ référentiel, celui du doit.
Conclusion : les tentations pour une dangereuse dichotomie Des réflexions bien sombres, formulées par au moins trois auteurs, ne sont pas pour rassurer dans le tableau peu reluisant qui tend à se dessiner et qui montre bien que même le droit n’est pas à l’abri des querelles de clochers contre-nature. Ainsi, René Cassin et Marcel Waline[33] bercés par l’espoir que : « […] aux monologues alternés du professeur qui risque de s’enfermer dans sa tour d’ivoire, et du juge à qui les ensembles risquent d’être masqués par les particularités des procès à lui soumis, devrait succéder un véritable dialogue, ou mieux […] 'un chœur à deux voix'. » ; mais aussi Norbert Rouland[34], surenchérissant : « On sait l’ignorance réciproque dans laquelle se tiennent en France théoriciens et praticiens. Or, prises isolément, ni la pratique, ni la théorie, ne suffisent à construire le réel. », ou encore Christian Atias[35], alarmant : « « Laisserons-nous s’interrompre le dialogue de l’Ecole et du Palais ? Laisserons-nous dire et croire que la théorie peut avoir raison contre une pratique qu’elle ignore et que la pratique doit se développer de manière autonome ? Les uns alimentent l’arbitraire en sombrant dans le fait. Les autres le couvrent en maintenant l’argumentation dans l’abstrait. » Ce constat amer ne date pas d’hier, puisqu’il est resté inchangé depuis voilà quasiment un demi-siècle. Oui, les praticiens et les théoriciens s’ignorent. Une vérité qui semble s’abattre de plein fouet sur les seuls juristes, en ce sens que dans nulle autre discipline académique une telle césure n’est observée entre les théoriciens et les praticiens. Ainsi que le rappelle ce vieux conte semblant tout droit tiré des Mille et Une Nuits[36], le droit est un Janus, c’est-à-dire que sa nature est d’en connaître la même ambivalence, soit encore des aspects pratiques (technique, « artistique ») et scientifiques (théorique, spéculatif). En effet, nonobstant cette ignorance entre théoriciens et praticiens une commune opinion fait surface : tous déplorent cette situation. Tous savent que la pratique et la théorie doivent s’efforcer de rendre compte, ensemble, car elles sont bien indissociables, de cet unique phénomène qui ne tolère pas d’être fractionné au gré des points de vue[37] : le phénomène juridique.
[1] En effet, il s’agit là d’une définition sinon française, à tout le moins occidentale du droit. Ainsi, les peuples extrême-orientaux ne placent-ils pas leur confiance dans le droit pour assurer l’ordre social et la justice. Certes, il existe un droit, mais il ne joue qu’un rôle subsidiaire. La préservation de l’ordre social repose essentiellement sur des méthodes de persuasion, sur des techniques de médiation et de conciliation propres à préserver l’harmonie et ressortissant de normes de comportement observées par crainte du mépris social (giri japonais, li chinois). C’est pourquoi, le cas japonais fournit-il l’exemple d’une culture juridique, qui, de manière globale, n’adhère à aucune des deux définitions du droit reçues dans le système français. En témoigne la langue, dans laquelle on ne trouve pas d’équivalent au vocable « droit ». Néanmoins, la nécessité conduit à établir des rapprochements. Ainsi, hô correspond-il plutôt à notre notion de droit objectif et kenri renvoie-t-il à celle de droit subjectif ; ce phénomène linguistique n’étant pas propre au Japon : il touche l’ensemble de l’Extrême Orient. V. Jauffret-Spinosi (C.), Les grands systèmes de droit contemporains, coll. Précis, Paris, éd. Dalloz, 11ème éd., 2002. [2] Cf. Cornu (G.) dir., Vocabulaire juridique, coll. Quadrige, Paris, PUF, 2000 ; Guinchard (S.) et Montagnier (G.) dir., Termes juridiques, coll. Lexique, Paris, éd. Dalloz, 11ème éd., 1998. [3] Dictionnaire de l’Académie française, tome 1, Paris, éd. Fayard – Imprimerie nationale, 9ème éd., 2001. [4] En latin ars, artis, féminin ; V. Rey (A.) dir., Dictionnaire historique de la langue française, tome 1, Paris, éd. Le Robert, 2ème éd., 1995 ; Chatelain (E.), Dictionnaire Français-Latin, Paris, éd. Hachette, 1999, Ernout (A.) et Meillet (A.), Dictionnaire étymologique de la langue latine, Paris, éd. Klincksieck, 2001. [5] Concernant la bibliographie en matière d’histoire juridique romaine, absolument pléthorique, nous nous contentons de renvoyer aux manuels d’introduction historique au droit et aux institutions les plus récents : Carbasse (J.-M.), Manuel d’introduction historique au droit, coll. Droit fondamental, Paris, éd. PUF, 2002 ; Castaldo (A.), Introduction historique au droit, coll. Précis, Paris, éd. Dalloz, 1999 ; Durand (B.), Chêne (C.), Leca (A.), Introduction historique au droit, coll. Pages d’amphi, Paris, éd. Montchrestien, 2004 ; Gasparini (E.) et Gojosso (E.), Introduction historique au droit et aux institutions, coll. Manuels, Paris, éd. Gualino, 2005 ; Gaudemet (J.), Les naissances du droit. Le temps, le pouvoir et la science au service du droit, coll. Domat droit public, Paris, éd. Montchrestien, 3ème éd., 2001 ; Gilissen (J.), Introduction historique au droit, Bruxelles, éd. Bruyland, 1979 ; Leca (A.), La genèse du droit, Aix-en-Provence, éd. PUAM, 1998 ; Lovisi (C.), Introduction historique au droit, coll. Cours, Paris, éd. Dalloz, 2001 ; Rigaudière (A.), Introduction historique à l’étude du Droit et des Institutions, Paris, éd. Economica, 2001 ; Rouland (N.), Introduction historique au droit, coll. Droit fondamental, Paris, éd. PUF, 1998 ; Thireau (J.-L.), Introduction historique au droit, coll. Champs Université, Paris, éd. Flammarion, 2001. [6] La définition de Celse ne nous est connue qu’indirectement par la citation qu’en fait le célèbre juriste de l’époque classique Ulpien, au livre 1er de ses Institutes, lui-même repris par l’empereur Justinien dans son Digeste, durant la première moitié du VIe siècle ap. J.-C.. [7] Parmi les ouvrages généraux les plus récents, Gaudemet (J.), Les institutions de l’Antiquité, coll. Domat droit public, Paris, éd. Montchrestien, 7ème éd., 2002 ; Imbert (M.), Institutions politiques et sociales de l’Antiquité, coll. Précis, Paris, éd. Dalloz, 1999. [8] Il faut donc regarder et comprendre le droit romain dépollué de nos habitudes de pensée héritées de la Révolution française, à la fois individualiste et étatiste.
[9] Ainsi, s’il était juste pour un Romain que seul le chef de famille (pater familias) exerce la puissance (patria potestas) sur les enfants, depuis 1970, il nous paraît juste que l’autorité parentale soit, en principe, exercée conjointement par les deux parents (cf. art. 372 et s. C. civ.). [10] V. Wintgens (L. J.), « Le concept du droit dans le national-socialisme », RIEJ, 26, 1991, pp. 89-110 ; Troper (M.), « Y a-t-il eu un Etat nazi ? », in Pour une théorie juridique de l’Etat, Paris, PUF, 1994 [11] CA Amiens, 22 avril 1898, Dalloz, note Roux ; à comparer avec CA Poitiers, 11 avril 1997, Dalloz, note Waxin. [12] Boyer (L.) et Roland (H.), Adages de droit français, Paris, éd. Litec, 4ème éd., 1999. [13] V. Posner (R. A.), Droit et littérature, trad. de l’anglais par Christine Hivet et Philippe Jouary, coll. Droit éthique société, Paris, PUF, 1996. [14] V. Cornu (G.), Linguistique juridique, coll. Domat droit privé, Paris, éd. Monchrestien, 1990 ; Corato (N.), Grandes plaidoiries et grands procès du XVe au XXe siècle, Issy-les-Moulineaux, éd. Prat, 2004. [15] On citera parmi les exemples les plus célèbres : Prud’hon, La Justice et la Vengeance divine poursuivant le crime, Paris, 1808, musée du Louvre ; Gandolfi (G.), La Justice, entre 1760 et 1762, musée du Louvre ; Benci (P.), La Justice, 1470, musée du Louvre ; Spranger (B.), La Prudence et la Justice, entre 1592 et 1595, Galerie des Offices de Florence, Rameru (S. de), Allégorie de la Justice, vers 1652, musée d’art et d’histoire de Genève. [16] V. Garapon (A.), L’âne portant des reliques. Essai sur le rituel judiciaire, Paris, éd. Le Centurion, 1985. [17] C’est ici un premier élément du rituel judiciaire, particulièrement développé devant les juridictions pénales. En effet, les normes pénales sont celles qu’une société tient pour touchant le plus directement son ordonnancement : à la gravité des faits doit répondre la valorisation de la loi. Le rituel opère un passage du désordre à l’ordre. Le procès débute par le rappel du crime commémoré afin de mieux être exorcisé. [18] Depuis le décret du 2 nivôse de l’an XI, le port de la robe à l’audience est obligatoire. [19] Neveu (B.), « Costume des juristes », in Dictionnaire de la culture juridique, Paris, éd. Lamy-PUF, 2003. [20] D’une part, la robe renvoie à l’histoire. C’est le cas de la toge (d’ailleurs encore aujourd’hui synonyme de robe) portée par les magistrats romains dépositaires de l’autorité de la res publica et dont le pan tombant sur l’épaule gauche se fait le lointain écho de l’actuelle épitoge (du grec epi -sur- et du latin toga –toge- l’épitoge est la pièce d’étoffe garnie d’hermine fixée à l’épaule gauche de la robe). L’Ancien Régime légua quant à lui le rabat (large cravate blanche formant plastron) pour des raisons liées à la mode, il est vrai. D’autre part, la robe renvoie à des considérations d’ordre symbolique. En effet, le droit ne va-t-il pas jusqu’à solliciter les couleurs pour se rendre impératif. Noir est la couleur du costume des auxiliaires de justice, tout comme celui des forces de police, le maillot de l’arbitre ou encore la soutane sacerdotale. Tous ces personnages sont là pour rappeler la règle et, au besoin, forcer son observation. Quant aux magistrats des hautes juridictions, ils se revêtent de rouge : la couleur qu’affectionne le pouvoir, la couleur de la souveraineté (des pourpres impériale et cardinalice à celle de la tunique laticlave). Le droit s’impose à notre rétine. Enfin, rappelons la symbolique de l’hermine, qui depuis Elien (II, 37) signifie innocence et pureté morale. Préférer la mort à la souillure, telle fut la devise de bien des noblesses. De manière générale, il convient encore ici de souligner que la robe est un vêtement ample. Or, cette ampleur, par la silhouette qu’elle induit, participe de la majesté accordée aux personnages qui portent la robe. [21] In Fexible droit, Paris, LGDJ, 1995, p.384, sur la naissance du Palais de Justice à l’époque du roi Salomon. [22] V. Chevalier (J.) et Gheerbrant (A.) dir., Dictionnaire des symboles, coll. Bouquins, Paris, éd. Robert Lafont /Jupiter, 1982. [23] La même symbolique est accordée au chêne dans les cultures romaine et barbare. Pour s’en convaincre, on se réfèrera au chêne du Jupiter Capitolin à Rome et à celui de Romawe en Prusse. [24] En latin, les deux substantifs « chêne » et « force » s’expriment par le même mot : robur ou parfois robor (Lucrèce, 2, 1131). [25] Nous ne rappellerons pas ici la signification fort bien connue des attributs dont les personnifications allégoriques de la justice sont classiquement flanquées et que sont le glaive et la balance. Cependant, précisons que Marianne est la déesse grecque de la liberté et qu’elle est traditionnellement représentée coiffée du bonnet phrygien (les Phrygiens sont un peuple d’Anatolie qui maintint sa culture et sa langue, même après les invasions des Cappadociens et des Galates en 275 av. J.-C.). De ces constations, nous pouvons tirer deux conclusions. Tout d’abord, la justice est libre, c’est-à-dire indépendante et du pouvoir politique et de l’arbitraire tirée de la subjectivité à l’égard des parties (ne dit-on pas qu’elle est aveugle) et elle ne saurait aller à l’encontre de la liberté. Cette première constatation s’entend aussi bien de la justice prise en tant qu’idéal de vie, que de l’autorité judiciaire qui doit nécessairement s’en inspirer. Ensuite, elle est un élément fondamental de notre système culturel et de préservation de son originalité à l’égard d’autres civilisations, en ce sens que nos juridictions en tranchant des litiges ou en fustigeant des peines, autrement dit en faisant ni plus ni moins qu’acte de juris dictio, ne font que rendre compte d’une conception philosophique de l’ordre social spécifique de notre droit et de notre pays. [26] Par exemple, si un plaideur entend produire un document à l’appui de sa prétention, il ne pourra pas aller le remettre à ses juges : l’huissier audiencier, recouvert du costume d’audience, vient le prendre et le donne au président.
[27] A. Rey & J. Rey-Debove (dir.), Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Paris, éd. Le Robert, 1985 [28] La séparation (Isolierung) du droit par rapport à la religion et à la morale est un aspect de la formation des Etats modernes et des révolutions bourgeoises à partir du XVIIe siècle, en ce qu’elles voient l’émergence simultanée du binôme Droit – Etat dans lequel les deux termes sont indissociables : il n’y aurait pas d’Etat sans Droit et, plus grave de Droit sans Etat. [29] « Ius naturale est, quod natura omnia animalia docuit » (« Le droit naturel est celui que la nature inspire à tous les animaux »), Ulpien, livre 1er des Institutes, cité au Digeste de l’empereur Justinien (I, I, 1, §3). [30] V. les principaux ouvrages d’introduction au droit : Aubert (J.-L.), Introduction au droit et thèmes fondamentaux du droit civil, coll. U, Paris, éd. A. Colin, 7ème éd., 1998 ; Cabrillac (R.), Introduction générale au droit, Paris, éd. Dalloz, 2ème éd., 1997 ; Carbonnier (J.), Droit civil introduction, coll. Thémis, Paris, PUF, 22ème éd., 1997 ; Ghestin (J.), Goubeaux (G.) et Fabre-Magnan (M.), Traité de droit civil, tome 1, Introduction générale, Paris, éd. LGDJ-Montchrestien, 4ème éd., 1994 ; Jestaz (Ph.), Le droit, Paris, éd. Dalloz, 1996 ; Malinvaud (Ph.), Introduction à l’étude du droit, Paris, éd. Litec, 1995 ; Mazeaud (H.) et Chabas (F.), Leçons de droit civil, tome 1, volume 1, Introduction à l’étude du droit, Paris, éd. LGDJ-Montchrestien, 11ème éd., 1996, Sourioux (J.-L.), Introduction au droit, Paris, PUF, 1990 ; Terré (F.), Introduction générale au droit, Paris, éd. Dalloz, 3ème éd., 1996. [31] Elle apparaît en concomitance avec la promulgation du Code civil (1804) et domine la science française du droit jusqu’en 1880. Les juristes considèrent alors que le Code est une œuvre neuve. Ce faisant, ils expliquent le Code sans tenir compte du passé, en l’isolant du milieu social dans lequel il est né et dans lequel il doit s’appliquer. Pour eux, le Code est un tout cohérent, qui contient toutes les solutions théoriques, dont l’analyse exégétique des textes légaux et leur combinaison, doit permettre la révélation. Les principaux représentants en sont : Maleville, Analyse raisonnée de la discussion du Code civil (1805-1814) ; Delvincourt, Cours de droit civil (1808) ; Proudhon, Cours de droit civil (1809) ; Toullier, Cours de droit civil (1811) ; Duranton, Cours de droit français suivant le Code civil (1825) ; Aubry et Rau, (1838-1844) ; Demolombe (1845-1876) ; Baudry-Lacantinerie (1895 et s.) [32] Gény (F.), Méthode d’interprétation et source en droit privé français, 1899 [33] M. Long, P. Weil, G. Braibant, P. Delvové, B. Genevois, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, Paris, éd. Dalloz, 12ème éd., 1999, V. la préface de la première édition, parue en 1956, rédigée par R. Cassin et M. Waline, p. V. [34] N. Rouland, Anthropologie juridique, coll. Droit fondamental, Paris, éd. PUF, 1988, p. 15. [35] C. Atias, Dalloz, 1998, Chronique, p. 140. [36] En réalité, ce conte fut rappelé par feu le doyen Georges Vedel dans son discours prononcé à l’occasion du bicentenaire du Conseil d’Etat, in Les annonces de la Seine, jeudi 16 décembre 1999, n°85, p. 11, et dont nous avons librement adapté la formulation, ainsi qu’il suit : Il était une fois, en Orient, en des temps que les limites de la mémoire humaine rendent difficiles à situer, un oncle très âgé, qui, n’ayant pu avoir d’enfant, décida d’organiser les trames de sa succession entre les seuls et uniques héritiers que le ciel ait accordé de lui donner : ces trois neveux. Ainsi, entreprit-il de leur léguer les dix-sept méhara de sa caravane, mais le destin, ce perfide et insatiable ennemi de la logique, voulut que ce fut de façon inégale : l’aîné fut gratifié de la moitié du cheptel, le cadet du tiers, et le benjamin du neuvième. Consulté sur le partage, le plus savant calculateur du pays, émérite mathématicien du moment, déclara le partage impossible. Exaspérés autant que désespérés de ne pouvoir entrer en possession de leur part, les trois frères se concertèrent et la voix cordiale et salvatrice de l’unanimité se fit bientôt entendre pour que l’affaire en soit remise à la sagesse du kadi, fin lettré et grand connaisseur des problèmes de droit. Et voici ce qu’il advint. Fort généreusement, ce juge fit aussitôt don à la succession d’un de ses propres dromadaires, ce qui eut pour effet de porter à dix-huit l’effectif de la caravane. L’aîné des héritiers prit alors sa part, la moitié, soit neuf dromadaires, le second le tiers soit six dromadaires, le dernier le neuvième, soit deux dromadaires. Neuf plus six plus deux, au total dix-sept méhara. Sur quoi le kadi reprend le sien. [37] « […] le droit, comme toute chose vivante, meurt d’être taillée en pièce ». A. Sériaux, Le commentaire de texte juridique, Paris, éd. Ellpises, 1997, p. 20.
|