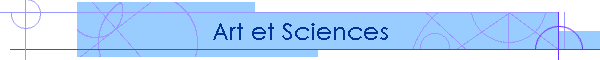
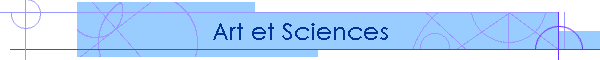 |
Droit d'auteurs et oeuvres musicalesPar Marie Fontaine
La protection juridique des œuvres est une des préoccupations essentielles des artistes appartenant au domaine de la musique. L’importance du travail et des investissements financiers qu’ils ont consentis afin d’élaborer leur création musicale justifie le souhait, à terme, d’en conserver la maîtrise et d’en récolter les produits financiers. Pour cela, divers régimes juridiques sont organisées par le droit de la propriété littéraire et artistique qui prévoit expressément à l’article L 112-2 du code de la propriété intellectuelle (CPI), la protection des « compositions musicales avec ou sans paroles », favorisant ainsi leur production. L’œuvre musicale est une œuvre de l’esprit dont les éléments constitutifs s’analysent comme des sons. Il s’agit donc d’une création sonore au sens large, c’est à dire englobant aussi bien les symphonies, les opéras, le rock que les illustrations sonores de campagnes publicitaires ou les bruitages. Au sein des œuvres d’art, l’oeuvre musicale, ainsi que l’a montré O. Laligant, possède une véritable singularité. Son existence n’est jamais que temporaire puisqu’elle ne dure que le temps de son exécution. Une fois l’œuvre exécutée, elle cesse immédiatement d’exister et bien qu’elle puisse être retranscrite de manière plus pérenne sur une partition, l’œuvre en elle-même, composée de sons, ne survit à la dernière note. De même, l’œuvre musicale, se distingue d’autres œuvres d’art par sa présence parcellaire, fragmentaire. On ne peut l’appréhender dans sa totalité, comme on le ferait d’une peinture car lorsque l’on perçoit une note ou un accord, cela implique nécessairement que les sons entendus l’instant d’avant se sont éteints et que ceux qui vont suivre ne sont pas encore perceptibles. Ces particularités nous invitent à nous interroger sur la manière dont le droit appréhende les œuvres musicales. Pour cela, il est nécessaire d’opérer une distinction entre deux activités artistiques intervenant dans toute réalisation musicale : la composition, réalisée par le créateur de l’œuvre et l’interprétation, exécution vocale ou instrumentale de l’œuvre. Que ces fonctions soient réalisées par une seule et même personne ou par deux artistes différents, elles font naître des protections juridiques distinctes. Alors que le créateur de l’œuvre musicale est protégé par le droit d’auteur, auquel nous limiterons ici notre analyse, l’artiste interprète bénéficie, sur sa prestation d’un droit voisin au droit d’auteur, conformément à l’article L.212-3 du CPI. Bien que la loi prévoie la protection de toutes les œuvres de l’esprit, le bénéfice des prérogatives offertes par le droit d’auteur, que nous envisagerons dans une seconde partie, est subordonné au respect de certaines conditions. Section1 : Une création originale de l’esprit, objet de la protection offerte par le droit d’auteur
Conformément à l’article L.112-1 du code de la propriété intellectuelle, le droit d’auteur protège toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. La notion d’œuvre de l’esprit, placée au cœur du dispositif de protection des droits d’auteur a été, en l’absence de définition légale, déterminée par la doctrine et la jurisprudence, qui a progressivement, posé deux conditions cumulatives. Ainsi, seules les œuvres de l’esprit suffisamment matérialisées et originales entrent dans le champ d’application des droits d’auteur et peuvent bénéficier de fait de leur protection juridique.
a) Une création de l’Homme Pour être considérée comme une œuvre de l’esprit au sens du droit d’auteur, l’œuvre musicale suppose l’exercice, par l’homme, d’une activité intellectuelle au sens large, c'est-à-dire englobant tant l’intelligence que la sensibilité. Elle doit être le produit de « l’activité fabricatrice mentale de l’homme ». Rompant avec une appréciation plus large de la notion de création adoptée par certains tribunaux de première instance, la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 6 octobre 1979, a expressément limité le champ de protection des droits d’auteur aux seuls enregistrements phonographiques, excluant en l’espèce, l’enregistrement de chants d’oiseaux. Ainsi, contrairement au domaine de la photographie où l’on considère que la fixation de l’image peut traduire la personnalité de l’auteur, un simple enregistrement d’évènements sonores, existant indépendamment de celui qui les enregistre (cris d’animaux, bruits de la nature, de l’activité urbaine, de machines) est perçu comme un acte neutre, dénué d’activité de création. On reconnaît l’existence d’une activité mentale puisque l’auteur choisi et agence librement les sons qu’il enregistre, mais cette activité n’apparaît pas fabricatrice en tant que telle et ne pourra être protégé que si la combinaison ou juxtaposition de sons révèle la personnalité de l’auteur. L’intervention de l’homme, si elle est fondamentale pour l’appréciation de l’œuvre au sens du droit d’auteur, n’a cependant pas à être consciente. L’intention de créer n’est pas ici un critère opérant puisque sont considérées comme des œuvres de l’esprit tant les compositions réfléchies de l’auteur que les improvisations. Ce débat a cependant été relancé avec l’avènement des nouvelles technologies et notamment la création d’œuvres musicales assistée ou réalisée à l’aide d’un ordinateur. Ce processus de création comportant des manipulations plus ou moins automatiques ou aléatoires, n’est pas, pour certains, le résultat d’une activité mentale fabricatrice de l’homme. Ce raisonnement apparaît cependant contraire à l’article L. 112-1 du CPI qui interdit la prise en considération du mérite de l’œuvre pour l’octroie de la protection. Ainsi, un arrêt du TGI de Paris du 5 juillet 2000, a précisé que « la composition musicale, assistée par ordinateur, dès lors qu’elle implique une intervention humaine, conduit à la création d’une œuvre originale comme telles protégeables ». Par conséquent, l’existence d’une intervention humaine, même minime, suffit à faire entrer la création dans le champ d’application des droits d’auteur dont seuls seront exclus les processus entièrement automatisés. Mais la création de l’œuvre musicale ne pourra faire l’objet d’une appropriation qu’à la condition d’avoir atteint un degré de formalisation la rendant matériellement perceptible.
b) Une création matérialisée
La création intellectuelle doit, pour bénéficier de la protection du droit d’auteur, revêtir une forme suffisamment particulière et précise afin de pouvoir être communiquée. Seule cette réalisation matérielle de l’œuvre sera protégée car les idées en tant que telles ne peuvent faire l’objet d’une appropriation privative. Elles sont, selon la formule désormais célèbre du doyen Desbois, « de libre parcours ». En droit d’auteur, il faut donc distinguer entre forme et contenu, la protection ne bénéficiant qu’à l’aspect sous lequel les idées se sont matérialisées. La matérialisation définitive de l’œuvre n’est en revanche pas nécessaire. Ainsi, des œuvres inachevées ou en cours de réalisation telles que les esquisses ou les ébauches peuvent prétendre à la protection fournie par le droit d’auteur, à condition évidemment qu’elles aient fait l’objet d’une matérialisation suffisante. L’œuvre ainsi matérialisée entre, du simple fait de son existence, dans le domaine de la protection offerte par le droit d’auteur, sous réserve qu’elle soit originale.
Pour être protégée, l’œuvre musicale, comme toute œuvre de l’esprit, doit être originale, c'est-à-dire qu’elle doit être marquée par l’expression ou l’empreinte de la personnalité de son auteur. Cette condition fondamentale, d’origine jurisprudentielle, est apparue au lendemain de la seconde guerre mondiale. En l’absence de définition légale, elle est appréciée discrétionnairement par les juges du fond.
a) L’originalité, un critère encore imprécis
Devant le refus de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 6 mars 1979, d’exercer un contrôle sur la qualification, l’appréciation de l’originalité est laissée aux juges du fond qui ont le devoir de rechercher si une œuvre a, ou non, un caractère original et de définir en quoi consiste l’apport intellectuel de l’auteur (Arrêt de la Cour de cassation, 2 mai 1989). Cela a donné lieu à nombreuses définitions, les juges se fondant sur des critères plus ou moins objectifs pour enfin conclure, à défaut d’harmonisation, que l’originalité est une « notion à géométrie variable dont le contenu varie selon le type d’œuvre en cause ». Le critère d’originalité a été longtemps assimilé à la notion de nouveauté. Ainsi, deux décisions de tribunaux de première instance de 1987 avaient exigé qu’il n’existe pas d’oeuvre antérieure semblable pour conclure à l’originalité. Cependant, il semble aujourd’hui que l’absence d’antériorité soit examiné comme un simple indice de la présence ou non de l’empreinte de la personnalité de l’auteur dans l’œuvre. Par conséquent, l’emprunt au folklore ou à des œuvres tombées dans le domaine public ne fait pas obstacle à la reconnaissance du caractère original de l’œuvre, à condition de justifier d’un apport personnel de l’auteur. Ainsi, la Cour de cassation, dans un arrêt du 1er juillet 1970, a jugé que les compositions de Manitas de Plata, bien qu’empruntant à des airs populaires ou folkloriques, pouvaient être considérées comme originales car ces airs « étaient assortis d’accompagnements personnels et procédaient d’un perpétuel renouvellement dans un style original ». En revanche, la qualité d’auteur a été refusée au présumé créateur de la chanson « boire un petit coup c’est agréable », au motif que cette chanson appartenait au folklore français et que l’auteur n’apportait pas la preuve d’une écriture ou d’une orchestration originale (Cour de cassation, 23 octobre 1962). Cette conception est renforcée par l’article L. 112-3 du CPI qui dispose que « les auteurs de traductions, d’adaptations, transformations ou arrangements des oeuvres de l’esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l’auteur de l’œuvre originale ». Ainsi, les œuvres dérivées telles que les variations, développements originaux de thème préexistants qui, tout en laissant l’œuvre reconnaissable, y ajoutent des éléments mélodiques ou en modifient l’harmonie et le rythme peuvent bénéficier de la protection offerte par le droit d’auteur (transformation d’une rhapsodie en valse, Cour d’appel de Paris, 30 avril 1970). Il en est de même des arrangements, orchestrations et adaptations qui transforment une œuvre pour en permettre l’exécution à une catégorie d’instruments autre que ceux pour lesquels elle avait été écrite. L’adaptateur doit néanmoins pour cela obtenir l’autorisation de l’auteur de l’œuvre adaptée (CA Paris, 24 janvier 1980) et faire preuve d’un apport original par rapport à l’œuvre initiale. Aujourd’hui, le concept d’originalité se rapproche de celui de création. L’œuvre, si elle n’est pas totalement nouvelle, doit être suffisamment singulière pour être distinguée de celles déjà existantes. Pour cela, les juges apprécient le critère d’originalité au regard de ce qui compose l’œuvre musicale, « qui est une combinaison de notes simples (mélodies) accompagnée ou non d’accords (harmonie) se succédant dans le temps selon une certaine cadence et périodicité (rythme) auxquels peuvent s’ajouter d’autres éléments (paroles, titres, bruitages) » (Droit d’auteur et droits voisins, Edition Francis Lefèbvre, Paris, 1996).
b) Appréciation du concept d’originalité
Pour apprécier le caractère original d’une œuvre, les juges s’attachent à déceler l’existence de trop fortes similitudes avec une œuvre préexistante. Pour cela, ils étudient les éléments caractéristiques de l’œuvre, à savoir la mélodie, le rythme et l’harmonie. La contrefaçon est facilement caractérisable lorsque la reprise porte sur ces trois éléments et donne ainsi « l’impression d’entendre une seule et même chose », conclusion formulée par la Cour d’appel de paris le 19 novembre 1985 à l’occasion d’une affaire opposant Loulou Gasté à un compositeur américain. A défaut, les juges examinent successivement et isolément les éléments caractéristiques de l’œuvre musicale. La mélodie, considérée par la Cour de cassation dans un arrêt de 1970 comme l’élément « le mieux reconnaissable par le néophyte », constitue l’élément central de la composition musicale. Elle est classiquement définie comme l’émission successive d’un nombre variable mais limité de sons. La mélodie fût assimilée à l’origine à l’idée et donc exclue de toute appropriation. Ainsi, en 1827, un tribunal avait pu considéré que ne constituait pas une contrefaçon le fait de reprendre des éléments mélodiques d’une œuvre de Rossini. Aujourd’hui, bien que les notes, au même titre que les mots, ne soient pas protégées, leur combinaison en revanche peut l’être, lorsqu’elle forme un ensemble original. Cette condition d’originalité de la mélodie est examinée par les juges au regard de la composition technique de l’œuvre, en prenant en considération le nombre limité de notes (7 dans la gamme) et donc la possibilité de ressemblances involontaires, appelée « rencontre fortuite ». La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 3 décembre 1987 a adopté une conception restrictive de cette notion de rencontre fortuite, refusant systématiquement les similitudes portant sur le refrain de la chanson. De plus, elle retient une appréciation très stricte de la rencontre fortuite en ce qui concerne les œuvres ayant fait l’objet d’une large diffusion auprès du grand public. En règle générale, la reprise de quatre mesures suffit à considérer une œuvre comme une contrefaçon. Ainsi, le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 5 mai 1939, a estimé que l’organisme de radiodiffusion « Radio côte d’azur » commettait une contrefaçon en en composant un indicatif d’émission avec quelques mesures de l’opéra-comique d’Ambroise Thomas Mignon.
Bien que le rythme soit un élément fondamental de l’œuvre musicale et que les juges aient pu estimer, dans un arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 28 septembre 1978 que « l’originalité d’une chanson est liée pour beaucoup à son rythme », ce dernier n’est pas, seul, un critère important dans la recherche d’originalité. Le rythme est un « groupement de sons selon une accentuation régulière, dont la dominante revient à des intervalles périodiques » (LUCAS, Traité de la propriété littéraire et artistique, Paris, Litec, 2000). De nombreux courants musicaux sont fondés sur la reprise d’un seul et même rythme et il est fréquent que le rythme d’une chanson ne soit en fait que la reprise d’un rythme préexistant. Ainsi, la musique rock, construite sur un rythme binaire, de même que la musique électronique ou le tango possèdent une structure rythmique propre au genre musical en question. Les cadences rythmiques (binaire, tertiaire, …) ainsi que la figure rythmique se répétant dans le morceau (rythme rock, swing, bossa nova, disco) ne pourront donc faire l’objet d’une appropriation et inversement, la reprise d’un rythme préexistant ne sera pas un élément suffisant pour conclure à une contrefaçon. Ainsi, l’originalité, de même que la création intellectuelle ne seront examinées qu’au regard de la juxtaposition du rythme à la mélodie (Cour de Cassation, 11 octobre 1989). Cette analyse vaut également pour l’harmonie, qui est une suite d’accords.
Les paroles de la chanson bénéficient également de la protection offerte par le droit d’auteur. Les juges de la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 18 mars 2003, ont condamné la reprise de vers d’une chanson. A l’occasion de l’éclipse solaire du 11 août 1999, le journal « Le figaro » avait repris dans un des articles le premier vers du refrain d’une chanson de Charles Trenet « Le soleil a rendez vous avec la lune ». Cet emprunt a été condamné par la Cour comme portant atteinte aux droits d’auteurs car contraire à l’ article L.122-4 qui interdit toute reproduction intégrale ou partielle d’une œuvre sans l’autorisation de son auteur. Cependant, les emprunts au langage courant peuvent faire obstacle à la reconnaissance de l’originalité d’une œuvre. Ainsi, si le titre « Parlez moi d’amour » a pu faire l’objet d’une protection, il n’en est pas de même pour les seuls termes d’ « amour » ou « mon amour ». Cependant, les juxtapositions de phrases courantes peuvent être considérées comme originales. Un arrêt de la cour d’appel de Paris du 2 avril 1997 a ainsi accepté de protéger une juxtaposition de séquences de phrases telles que « va mourir », « va dormir », « va te coucher tôt » et « j’ai la haine », « cette juxtaposition suffisant à composer par son agencement arbitraire et en dépit des emprunts aux courant d’expression du mouvement RAP, une phrase originale, reconnaissable en elle-même ».
Lorsque l’œuvre musicale entre dans le champ d’application des droits d’auteur, son créateur bénéficie, du simple fait de sa création de prérogatives tant morales que patrimoniales.
Section 2 : Contenu de la protection offerte par le droit d’auteur
Les droits d’auteur bénéficient, conformément à l’article L 113-1 du CPI, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est publiée. En ce sens, l’auteur n’est donc pas tant celui qui crée que celui qui divulgue, d’où l’importance, en l’absence d’exigence de formalités particulière, de se constituer la preuve d’une première divulgation afin de bénéficier des prérogatives conférées à l’auteur.
L’article L 111-1 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle est formel : « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporel exclusif et opposable à tous ». Ainsi, contrairement aux droits de propriété industrielle, l’octroie de la protection du droit d’auteur à une œuvre n’est soumise à aucune condition de formalités. Le dépôt légal des œuvres musicales est une formalité administrative et non une condition nécessaire à leur protection par le droit d’auteur. S’agissant des œuvres qui ne font pas l’objet d’exploitation publique, l’absence d’accomplissement de formalités peut poser certaines difficultés. En effet, en cas de contentieux, il peut être utile de disposer d’une preuve de la date de création de l’œuvre, permettant ainsi d’attester de son antériorité et d’en revendiquer la paternité. La preuve pouvant être apportée par tous moyens, plusieurs modes peuvent être utilisés. L’auteur peut avoir recours aux services d’un officier ministériel (notaire ou huissier) ou déposer l’œuvre auprès d’un organisme de gestion collective des droits (SACEM par exemple). Il est également possible d’acquérir une enveloppe Soleau, vendu par l’INPI comprenant un support de l’œuvre que l’organisme conservera durant cinq ans. Enfin, l’auteur peut envoyer, à lui-même ou à un tiers, un exemplaire de l’œuvre par courrier recommandé avec accusé de réception (sous pli fermé). L’artiste, reconnu comme auteur d’une œuvre musicale, bénéficie sur cette œuvre de prérogatives morales et patrimoniales.
Les auteurs disposent sur leurs œuvres d’un droit de propriété sur la création (distinct de la propriété sur l’objet, matérialisation de la création) qui leur confère deux types de prérogatives prévues à l’article L. 111-1 du CPI : les droits patrimoniaux permettant à l’auteur de déterminer les conditions d’exploitation de l’œuvre et les droits moraux protégeant les droits inhérents à la personnalité de l’auteur.
a) Les droits patrimoniaux
L’auteur, en vertu de l’article L. 123-1 du CPI, se voit reconnaître le droit exclusif d’exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire. Ce monopole d’exploitation lui confère le droit de déterminer librement toutes les modalités de représentation et de reproduction de son œuvre et donc de les subordonner au paiement d’une rémunération. On entend par représentation de l’œuvre sa communication au public, par un procédé quelconque. L’autorisation de l’auteur sera ainsi nécessaire non seulement pour l’exécution d’une prestation (spectacle, concert) ou l’audition d’enregistrements mécaniques (diffusion par disques dans les discothèques, par exemple), mais aussi pour la diffusion de musique dite « fonctionnelle » (messages d’attente, ascenseurs). Le droit de reproduction concerne quant à lui la fixation matérielle de l’œuvre, quel qu’en soit le procédé, permettant une communication indirecte au public. L’auteur sera donc seul compétent pour autoriser la reproduction graphique (reprise sur papier de partitions musicales) et la reproduction mécanique (phonogrammes, support audio, multimédia) de l’œuvre. Cette autorisation sera également nécessaire pour les œuvres dérivées ou composites. A titre d’exception à ce monopole d’exploitation, la loi autorise les représentations privées et gratuites effectuées dans un cercle de famille, les reproductions réservées à l’usage privé du copiste, les analyses et courtes citations, les présentations à titre d’information sous réserve de la mention du nom de l’auteur, les parodies, pastiches et caricatures, les actes nécessaires à l’accès au contenu d’une base de données électronique, dans les limites de l’utilisation prévue par contrat. Les droits patrimoniaux sont accordés à l’auteur jusqu’à son décès et ensuite à ses ayants droit durant soixante dix ans. A l’expiration de cette période, l’œuvre tombe dans le domaine public et est en principe libre d’exploitation. A ces prérogatives patrimoniales, s’ajoutent des droits moraux, consécration juridique des liens étroits existant entre l’auteur et son oeuvre.
b) Le droit moral
Le droit moral est un droit perpétuel attaché à la personne de l’auteur qui de son vivant pourra seul l’exercer. Il est inaliénable ce qui signifie qu’il ne pourra pas être cédé mais est transmissible aux héritiers de l’auteur. Il se compose de quatre prérogatives distinctes. Le droit de divulgation selon lequel seul l’auteur est habilité à porter son œuvre à la connaissance du public, lui permet de décider librement du moment et des conditions dans lesquelles il fera connaître son oeuvre. Ainsi, une œuvre divulguée sans le consentement de l’auteur constitue une contrefaçon, ce qui lui permet de se soustraire aux obligations issues d’un contrat de commande. Le droit de paternité de l’œuvre assure à l’auteur la possibilité d’imposer la mention de son nom ou pseudonyme et des ses qualités sur toute matérialisation de son oeuvre. La Cour d’appel de Paris, le 11 septembre 1982 a ainsi considéré que l’absence de mention du nom du parolier de la version originale de la chanson « My way » par l’éditeur du Guiness Book constituait une violation du droit à la paternité de l’auteur. Le droit au respect de l’œuvre fonde l’auteur à s’opposer à toute atteinte à l’intégrité de son œuvre, c'est-à-dire à toute altération ou modification qui dénaturerait sa création, de même qu’à toute exploitation ou adaptation qui ne respecterait pas l’esprit de l’oeuvre. Dans un arrêt du 21 juin 1988, la Cour d’appel de Paris a sanctionné la juxtaposition de deux extraits des paroles d’une chanson en un seul extrait pour violation du respect de l’intégrité de l’œuvre. Elle a de même considéré, dans un arrêt du 20 février 1990, que l’utilisation d’une œuvre musicale à des fins publicitaires est une violation du respect de l’œuvre. Enfin, le droit de repentir ou de regret permet à l’auteur d’apporter des modifications à l’œuvre déjà divulguée ou à en interrompre une diffusion déjà commencée. Pour exercer son droit de repentir, l’auteur devra indemniser préalablement les éventuels cessionnaires des droits d’exploitation non seulement des pertes réellement subies du fait de l’exercice du droit de reprise, mais également du manque à gagner (article L 121-4 du CPI). Cette condition, lourde de conséquences pour l’auteur conduit, en pratique, à le décourager d’exercer ce droit. L’utilisation d’une œuvre musicale, sans l’autorisation de son auteur, constitue une violation des droits patrimoniaux ou moraux considérée, sauf exception, comme une contrefaçon. Le contrefacteur encours des sanctions à la fois civiles et pénales. Il peut être condamné à des dommages-intérêts ainsi qu’à des mesures visant à faire cesser la violation, et si la contrefaçon est retenue au pénal, à trois ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende (article L. 335-2 et L. 335-4 du CPI). Au regard des conditions et des modalités de protection des œuvres musicales par le droit d’auteur, on constate donc que le droit ne prend pas en considération les spécificités propres à ces œuvres, dont le régime juridique est identique à celui des autres œuvres de l’esprit. Cela accentue encore la nécessité de préciser le critère d’originalité, notion centrale des droits d’auteur. BIBLIOGRAPHIE S. Aubert, « Les méthodes d’appréciation de la contrefaçon en droit d’auteur », mémoire DEA droit privé, Aix-en-Provence, 2002, 73 p. P. Desjonqueres, « Les droits d’auteur, guide juridique, social et fiscal », , éd Juris service, Paris, 1974, 351 p. T. Dussart, « Le parcours juridique de l’artiste musicien : de l’édition musicale à la production phonographique », mémoire DEA droit des médias, Aix-en-Provence, 2004, 146 p. B. Khalvadjian, « Les droits de l’artiste en matière musicale », mémoire DEA droit des médias, Aix-en-Provence, 2003, 147 p. O. Laligant, « La véritable condition d’application du droit d’auteur : originalité ou création ? », Presse universitaires d’Aix-Marseille, Aix-en-Provence, 1999, 441 p. X. Linant de Bellefonds, « Droits d’auteur et droits voisins », 2ème éd, Dalloz, Paris, 2004, 564 p. J.L. Piotraut, « Droit de la propriété intellectuelle », Ellipse, collection référence, 2004, 240 p. P. Tafforeau, « Droit de la propriété intellectuelle », Gualino éditeur, Paris, 2004, 554 p. « Droit d’auteur et droits voisins », Ed Francis lefebvre, Levallois, 1996, 780 p.
|