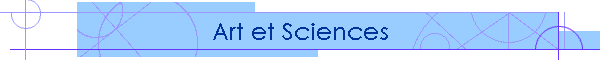
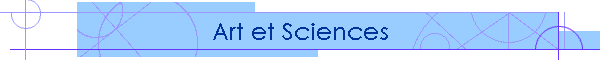
|
La couleur : De la chimie dans l'artPar Sophie Martinet ‘’L'Art" et la "Chimie" : quel lien pourrait-il y avoir entre ces deux mots ? Et bien voilà une réponse parmi d’autres : la matière !
IntroductionCouleur : ‘’ -1. Sensations que produisent sur l’œil les radiations de la lumière, telles qu’elles sont absorbées ou réfléchies par les corps. -2. Substance ou matière colorante.’’ Voilà donc la définition du mot couleur selon le Larousse. Et si la couleur c’était bien autre chose ? La couleur est, par elle-même, un langage permettant de communiquer. C’est un aspect de la perception visuelle qui va permettre de reconnaître les choses autrement que par leur forme ou leur texture. L’homme ne s’est pas contenté d’admirer les couleurs offertes par la nature, mais en a fait très tôt usage. Ainsi, dès la préhistoire, les artistes ont su retrouver dans la nature, ou concevoir, les pigments utiles à leurs œuvres. Durant cette période, la couleur était essentiellement utilisée dans la décoration de l’habitat (dessins préhistoriques, tableaux, bijoux, objets,…), et plus rarement dans les tissus (tentures, tapisseries, vêtements…). On peut parler des fameuses grottes préhistoriques de Lascaux, qui sont une magnifique œuvre colorée où le rouge, le noir et l’ocre dominent. A la période égyptienne, les artisans inventent le bleu et le vert, qui seront considérés plus tard comme les premiers pigments synthétiques. Mais c’est au début du XIXe siècle, avec l’essor fantastique de la chimie synthétique que vont s’offrir une extraordinaire quantité de couleurs. Et c’est à la fin de ce siècle que l’utilisation de la couleur s’est considérablement accrue siècle avec les pigments artificiels (teinture des vêtements, pigmentation des plastiques,…) et les systèmes à émission de couleurs (luminescence avec la télévision, cristaux liquides,…). Cette activité s’est d’ailleurs essentiellement développée dans le domaine de la décoration et du divertissement (activités du spectacle).
Ainsi, la chimie a joué, aux différentes périodes de l’histoire, un rôle considérable dans le développement des matières colorantes.
Afin de comprendre comment la chimie et la couleur peuvent être étroitement liées, nous parlerons d’abord de la production de la couleur puis de la restauration des œuvres d’art, où là aussi, la chimie va permettre d’aider la couleur.
1. La production des couleurs Il existe jusqu’à quinze moyens différents de produire des couleurs, mais seuls les pigments et les colorants jouent le rôle le plus important.
Les pigments
Ce sont des matières solides et insolubles, connus et utilisés par l’homme depuis des milliers d’année. Ce sont des substances chimiques organiques (à base de carbone et d’hydrogène) ou minérales. Ce sont eux, qui, en interaction avec la lumière, vont faire exister la couleur. Si, dans les débuts, les pigments naturels ont été privilégiés, l’homme a assez vite appris à les transformer par chauffage, utilisant ainsi l’une des premières techniques de la chimie. De nos jours, les pigments sont tellement omniprésents (peintures, écrans de télévision, automobiles et autres) qu’ils passent souvent inaperçus. Tout ceci nécessite donc une industrie chimique complexe et performante qui produit environ cinq millions de tonnes de pigments par an. En fait, pour être utilisés, ils doivent être mêlés à un liant ("mouillés par un liant", disent les chimistes), formant ainsi une peinture ou ce que l'on appelle un "colorant’’.
Les colorants
Comme les pigments, les colorants sont utilisés par l’humanité depuis la préhistoire. Ils sont tous issus de la synthèse chimique. On distingue les colorants d’origine animale, et les colorants d’origine végétale : - Les colorants d’origine animale. Le plus célèbre est la pourpre de tyr obtenue à partir de coquillages marins. On peut citer aussi le kermès et la cochenille pour les colorants rouges. Le kermès est obtenu à partir d’insectes parasites du chêne mais a été remplacé très vite par la cochenille comme colorant rouge dans l’alimentation. - Les colorants d’origine végétale. Parmi les nombreux colorants de ce type, le plus connu est l’indigo. Ce bleu est issu des feuilles d'un buisson, l'INDIGOFERA, dont il existe plusieurs variétés qui poussent en Inde, en Egypte et au Moyen-orient.
On peut donc comprendre que ‘’la couleur’’ peut être d’origine aussi bien naturelle que synthétique. La chimie intervient donc déjà dans la création de la couleur… 2. La restauration
Mais voilà, la couleur n’est pas inaltérable dans le temps et aujourd’hui, nombreuses sont les œuvres d’art picturales qui ont besoin d’un ‘’bon lifting’’, je veux parler bien sûr de la restauration. Mais avant de parler de la restauration d’un tableau, il faut d’abord savoir de quoi est-il constitué.
2. 1. Notions sur la peinture traditionnelle
Une œuvre picturale est constituée d’un ensemble de couches superposées sur un support, qui peut être soit de la pierre, du bois, du papier ou bien alors de la toile. On discerne alors trois couches principales :
Í Une couche de préparation (qui va lisser le support pour avoir une uniformité) Í Une couche picturale (peinture) Í Une couche de vernis (pour protéger)
Nous allons donc parler plus précisément des deux dernières couches.
La couche picturale est constituée d’une superposition de couches de peinture à base de pigments (vus dans le chapitre précédent) et de liant. Ce sont les pigments, dispersés sous forme de fines particules qui vont apporter la couleur et l’opacité. Le liant, lui, va jouer un rôle primordial dans la peinture en permettant la tenue durable de la pâte pigmentée sur le support. On utilise souvent l’huile comme liant, mais aussi les cires, ainsi que le jaune d’œuf, ou bien tout simplement l’eau.
La couche picturale est alors recouverte d’un vernis, qui va jouer le rôle de protection et de conservation en formant une couche solide pour protéger la surface tout en conférant un aspect uni.
Les deux plus grands facteurs d’altération d’une œuvre d’art sont l’humidité et la lumière. La variation du taux d’humidité fait que le support gonfle et se détend ; la couche de peinture en surface se craquèle et se fend. La lumière, elle, fait jaunir le vernis.
Pour bien comprendre l’utilisation de la chimie dans la restauration des œuvres d’art, nous allons prendre comme exemple la restauration des Noces de Cana. 2. 2. La restauration des Noces de Cana
‘’Les Noces de Cana’’ est un tableau de Paolo Caliari (appelé Véronèse). Il a été réalisé en 1563, et représente un épisode du nouveau testament : le miracle de Jésus changeant l’eau en vin à la demande de la vierge au cours d’un repas de noces à Cana en Galilée.
Cette œuvre d’art a fait l’objet d’une importante restauration de 1990 à 1992. Elle se trouve aujourd’hui dans la salle des Etats du Louvre, face à la célèbre Joconde de Léonard de Vinci. C’est le plus grand tableau du Louvre (6,77m de hauteur sur 9,94m de largeur).
La restauration a été menée avec une très grande rigueur par le Laboratoire de Recherche des Musées de France et de nombreuses analyses physico-chimiques ont été effectuées, qui ont permis, entre autre, d’importantes découvertes sur l’évolution du tableau, et sur certains faits insoupçonnés…
Pour commencer, le tableau est nettoyé, par l’élimination des poussières à sec ou à l’eau avec quelques gouttes d’ammoniaque.
Les restaurateurs enlèvent ensuite, à l’aide de solvants, une partie de la couche de vernis originale du tableau et ainsi redonner de l’éclat aux couleurs. On procède souvent par mélange de solvants, et on en recherche un qui va permettre d’enlever la couche superficielle du vernis sans ramollir, ni altérer la peinture en dessous. On fait alors des essais à l’aide d’un bâtonnet de verre. Une fois le mélange trouvé, on procède donc à l’allègement du vernis.
Dans le cas du tableau ‘’Les Noces de Cana’’, on a découvert que le mélange de solvants utilisé pour l’allègement des vernis jaunis, inoffensif pour les autres couches de couleur du tableau, s’est révélé actif sur la peinture rouge du manteau de l’intendant (en bas à gauche du tableau). Un vert insensible aux mêmes solvants est apparu.
L’analyse des pigments a montré que la couleur verte du fameux manteau était donnée par un acétate de cuivre, plus communément appelé ‘’vert-de-gris’’.
La couleur rouge a été obtenue par un mélange de sulfures d’arsenic orangés et jaunes, et d’un ocre rouge.
Le travail de restauration est donc extrèmement délicat. Il doit permettre d’améliorer l’état de l’œuvre sans trahir la pensée originelle de l’artiste. C’est grâce aux techniques d’analyse et de mesure que l’on pourra rendre un peu de son ‘’âme’’ à une œuvre…
3. Conclusion
Vous avez donc pu voir à travers un exemple bien concret que la chimie faisait partie intégrante de la couleur. En plus d’être à son origine, la chimie est aussi présente pour sa ‘’reconstruction’’.
Voilà donc la preuve que cette discipline à la fois controversée et critiquée est à l’origine de beaucoup de choses, et notamment de l’art !
|